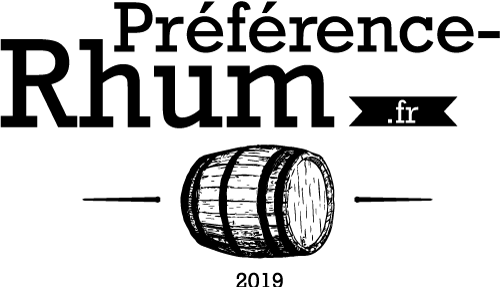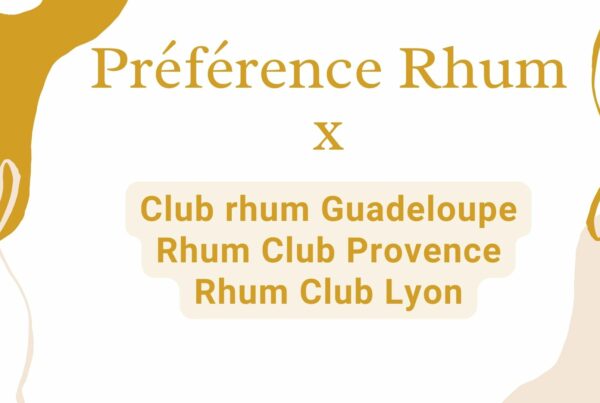Bien au-delà de la mer des caraïbes et de ses précieuses Antilles, au-delà de l’océan indien et de sa pépite réunionnaise, déjà abordée dans un article sur les rhums de l’Ile, se trouve la mer de Corail qui borde l’océan pacifique et où l’on trouve un territoire d’outre-mer méconnu : La Nouvelle-Calédonie.
Un survol historique
De 1853 à 1988
L’histoire de l’archipel est riche et sans pouvoir la résumer en quelques lignes, il nous faudra bien cependant la présenter succinctement, au moins pour remettre en contexte cette terre méconnue du grand public et donner un éclairage sur les évènements récents. Baptisée New-Caledonia par l’explorateur anglais James Cook un siècle auparavant, la nouvelle Calédonie deviendra une possession française en 1853. L’ile principale appelée Grande-Terre servira à accueillir les bagnards de l’état français. Une cohabitation plus ou moins harmonieuse s’établissant avec les peuples autochtones appelés Kanaks, constitués d’une multitude de tribus ayant chacune leur langue, leur tradition et leur terre ancestrale. L’archipel est développé par la France en tant que Colonie pénitentiaire avec le but avoué de renforcer la présence française dans le pacifique face aux anglais et aux néerlandais. La main d’œuvre que constituent les bagnards va aider à de nombreux travaux réalisés sur l’ile que ce soit dans autour de la garnison avec ce qui deviendra Nouméa ou en brousse avec la construction de routes, de ponts et de tunnels.
Les bagnards seront employés un temps à la culture de la canne, dans le but de produire du sucre avant l’effondrement de la valeur marchande de celui-ci. Aujourd’hui il n’y a plus de production sucrière sur l’ile, le gouvernement français ayant privilégié l’exploitation des mines de nickel qui font la richesse de l’ile. Pour le développement de cette terre on va encourager la colonisation, et pour inciter les bagnards ayant purgé leur peine à s’installer durablement on va leur donner des terres et faire venir des femmes afin qu’ils s’établissent sur l’ile. S’ensuivra une série de traités qui permettront aux premiers habitants de l’ile de conserver certaines terres appelés terres coutumières. La population de bagnards ira jusqu’à deux tiers des européens présents dans l’archipel ce qui développera de vives tensions, l’administration pénitencière s’octroyant en effet les meilleures terres, que ce soit pour elle ou pour inciter les bagnards à pérenniser leur présence sur l’ile. Les colons se plaindront de la main d’œuvre peu couteuse et déloyale que constituent les bagnards. On cessera à la fin du XIXème siècle les convois de prisonniers sur l’archipel. Le gouverneur d’alors indiquant qu’il fallait selon lui « fermer le robinet d’eau sale ».
L’administration coloniale doit gérer la politique foncière avec l’implantation de ses colons et l’intégration des bagnards mais prive ainsi les autochtones de leurs terres. De nombreuses révoltes éclateront avec « l’indigénat ». Les relations entre les différentes tribus Kanaks et les colons sont sources régulières de tensions, mais cela ne freinera pas le développement de la Nouvelle-Calédonie qui connaitra un essor considérable avec la découverte de grosses concentrations de nickel sur Grande-Terre.
A l’issue de la seconde guerre mondiale le code de l’indigénat est aboli et les kanaks accéderont petit à petit à la citoyenneté française. L’ile connaitra une relative prospérité avec l’accroissement de la demande « d’or vert » à la fin des années 60. Une nouvelle vague d’immigration viendra s’installer pour profiter du boom du nickel.
Cela n’empêchera pas les tensions entre Kanaks et Colons de perdurer pour atteindre leur paroxysme au milieu des années 80 et de culminer en 1988 avec une prise d’otage sanglante à Ouvéa.
De 1988 à aujourd’hui
Depuis, les indépendantistes kanaks et le gouvernement français ont eu de nombreux échanges avec plusieurs tentatives d’accord mais aucune n’a abouti à un accord durable. Les inégalités restent nombreuses, la pauvreté et la richesse se côtoyant sur l’archipel exacerbent forcément les tensions. La situation politique extrêmement tendue a provoqué de vives tensions en 2018 et à des événements encore plus violents en 2024, qui ont entrainé la mort de 14 personnes. L’état d’urgence a été déclaré à l’époque et si la présence massive de militaires français sur Grande-Terre a permis d’apaiser un peu les esprits, les tensions sur le territoire restent palpables après plus d’un an. L’économie de l’ile s’est écroulée. Il y a eu des départs massifs à la suite de ce qu’au-delà du terme « évènements », il faudrait appeler guerre civile car, quelles que soit vos opinions, vous étiez assimilés par certains à un camp ou à un autre. Même après un retour au calme, les gens qui ont vécu ces évènements et qui se sont retrouvés cloitrés à leurs domiciles pendant quelques semaines peinent à envisager un avenir radieux sur l’ile. Il y a urgence à trouver des accords qui permettront aux différents peuples que constituent la population calédonienne aujourd’hui d’envisager un avenir commun.
Petit mot de contexte (de l’auteur de ces lignes)
C’est dans ce contexte que j’ai personnellement décidé de quitter la métropole (et de délaisser le Whisky Live 2025) pour aller m’installer quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Préférence Rhum au cœur de l’actu ! Pour la petite histoire, j’ai écouté à la radio avant de partir, un reportage sur les émeutes ou l’on donnait la parole avec un chef d’entreprise local qui possédait une distillerie et qui avait vu ses locaux subir 9 cambriolages successifs. Tiens, on produirait donc du rhum en Nouvelle-Calédonie ? J’allais profiter de mon séjour sur l’ile pour tenter de rencontrer Philippe Bruot, le gérant de la distillerie Terre du Sud située à la Coulée (ça ne s’invente pas) au sud de Grande-Terre.
Terre Du Sud, l’interview
Préférence-Rum.fr : Bonjour Philipe Bruot, merci de m’accorder un moment, je sais que tes journées sont chargées.
Avant de rentrer dans le cœur du sujet je voulais savoir ce que tu faisais avant de créer ton activité en 2016 et ce qui t’avait incité à te tourner vers le rhum.
Philippe Bruot : Bonjour, à mon arrivée en nouvelle Calédonie il y a 25 ans je travaillais dans la conception de cuisines et d’entrepôts réfrigéré. J’ai travaillé à la réfection et à l’aménagement de la plupart des cuisines d’hôtels de l’ile ainsi qu’à la construction de vastes zones réfrigérés. Concernant ma passion pour le rhum j’ai toujours été intéressé par les bons spiritueux. La législation de l’ile ayant une tolérance pour la production d’alcool personnelle et non commerciale, j’ai pu fabriquer de petits alambics et commencer à distiller du jus de canne en petite quantité. Ayant accès à du matériel de cuisine professionnel j’ai pu perfectionner et optimiser le fonctionnement d’un alambic et d’une colonne de distillation, la part mécanique m’intéressait autant que la production d’alcool.
J’ai vu le potentiel avec les variétés de cannes de l’ile et j’ai décidé de me lancer dans la production. Ensuite, j’ai commandé un alambic Stupfler réputé pour le respect des arômes présent dans le vin de cannes ainsi que des cuves inox permettant la fermentation et le stockage du distillat. J’ai alors reçu un appel des autorités m’expliquant que je ne pouvais pas distiller en grande quantité en zone d’habitation (rires) mais qu’ils pouvaient me proposer un lieu dans une zone industrielle. C’est au pied du Monde Dore que j’ai donc installé ma distillerie, à la Coulée (nom de la rivière qui s’écoule du fameux mont). J’ai démarré les distillations officielles en 2016.
P-R : Est-ce que tu peux nous présenter succinctement ta gamme qui est un peu méconnue en métropole ? Tu fais du rhum traditionnel et du rhum agricole je crois…
PB : Alors techniquement je n’ai pas le droit d’inscrire rhum agricole sur mes bouteilles. La législation française ne me le permet pas. (Je me permets ici une petite remarque sur le fait que ce qui est possible à la réunion devrait l’être en Nouvelle-Calédonie, mais Philippe m’explique que certaines choses sont possibles dans les DOM, mais pas dans les TOM).
En revanche le processus de fabrication est bien celui d’un rhum agricole, je ne peux juste pas le valoriser comme tel. J’utilise également de la mélasse qui vient de Nouvelle-Zélande pour produire mon rhum traditionnel. La production de sucre sur l’ile a été complètement abandonnée il y a plusieurs années. Et j’ai aussi une vaste gamme de rhums arrangés.
P-R : Si la production de sucre a cessé il y a de nombreuses années comment se fait-il qu’il reste de la canne sur l’ile ?
PB : Déjà parce l’ile est vaste et que la canne est une culture millénaire et résistante. Le fait qu’il n’y ai plus de champs de cannes comme au temps de l’industrie sucrière ne signifie pas qu’il n’y ai plus de canne. Beaucoup de locaux continuent à entretenir dans leurs jardins ce qu’on appelait des touffes. Quelques pieds qui servaient de bonbon local pour les enfants, on s’en servait pour sucrer, mais aussi de brosse à dent ! On coupe la tige et on se frotte les dents avec les fibres de la canne pour les nettoyer ! (Astucieux mais je me demande si cette technique est vraiment validée par l’association bucco-dentaire française…)
Puisqu’il restait des cannes présentes sur l’ile, il n’y avait qu’a en replanter pour obtenir de quoi produire assez de vesou pour produire un rhum agricole local.
P-R : Et alors est-ce que tu as eu de bonnes surprises en distillant cette canne locale ?
PB : Avant de me lancer je savais que les cannes de l’ile avaient un fort potentiel. Certaines variétés sont endémiques à l’ile et après recherche il s’avère que ces variétés n’ont subi aucune hybridation depuis plus de 2000 ans que la canne est présente sur l’ile. (Je me permets ici un petit interlude historico-culturel : la canne à sucre a une grande importance dans la culture Kanak. En effet, les entre nœuds de la canne symbolisent les grands jalons de la vie humaine. Souvent les premiers échanges entre les différentes tribus afin d’envisager un futur mariage incluent de la canne à sucre. Et on la retrouve aussi dans les échanges coutumiers).
La canne à sucre étant originaire de Nouvelle-Guinée et du sud-est asiatique, elle n’avait que quelques milliers de kilomètres à franchir pour s’installer en Nouvelle-Calédonie. Les recherches récentes ont d’ailleurs révélé la présence d’un génome propre à la canne Calédonienne. Avec une association de passionnés chevronnés de la canne nous avons pris contact avec une chercheuse de l’IRD (Institut de Recherche et de Développement, très attaché à l’entretien des ressources de notre planète) Elle a pu identifier le génome de la canne et comprendre d’où il venait. Aujourd’hui ce collectif regroupe des planteurs et des amoureux de la canne de Nouvelle-Calédonie, mais aussi du Vanuatu, de la Polynésie française, des Fidji… L’idée est de tout faire pour valoriser et préserver ces cannes spécifiques à chacune des iles et de mettre ainsi en valeur leur terroir.
P-R : Wow ! C’est captivant, on comprend mieux pourquoi tu as décidé de te lancer dans l’aventure. J’imagine que tu as dû tenter de produire des rhums mono-variétaux ?
PB : Bien sûr, même si ceux-ci sont difficiles à valoriser pour le marché néo-calédonien. En effet alors que la législation m’interdit d’inscrire rhum agricole sur mes étiquettes, elle est beaucoup plus permissive pour certains qui peuvent indiquer rhum sur des produits trafiqués et bourrés de colorants et d’additifs. La culture locale n’étant pas tournée vers une consommation pure du rhum je me retrouve en concurrence avec des produits dont les frais de productions sont ridicules. De notre côté on s’attache à tout produire en écologie biologique certifiée, on trace chacune des cannes, on s’assure que les planteurs soient correctement rémunérés et valorisés et on se retrouve en rayon avec des rhums qui ont la moitié de notre prix de vente minimum.
Il y a notamment 3 cannes endémiques à l’ile que j’ai envie de distiller et qui révèlent à mon avis la richesse du terroir de l’ile. Il y a la canne tharêt dont le cœur est vert et qui produit un vesou vert franc. J’ai réussi à en distiller et le jus de cannes avait la couleur de la pelouse ! (rires) La vinasse qui restait à la fin du distillat restait verte et ne s’oxydait pas. Il y a deux autres cannes que je n’ai vu nulle part en dehors de l’ile, la canne du chef dont l’intérieur est orangé et la canne langouste dont l’intérieur est rouge. Ces deux cannes ne poussent que sur des territoires appartenant aux tribus… C’est donc assez compliqué de s’en procurer mais j’ai bon espoir et je parlemente avec les chefs des tribus pour essayer d’expliquer notre démarche.
Aujourd’hui compte tenu de la tendance du marché mes parcellaires sont malheureusement partis en blends…
P-R : Effectivement, il y a un marché pour les rhums monovariétaux ou mono-parcellaire en métropole mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas ici. Et c’est bien dommage quand tu évoques les cannes présentes sur le territoire. Parlons un peu du processus de distillation. Ton alambic permet une distillation en une seule passe c’est bien ça ?
PB : Absolument cet alambic me permet de passer d’un vin de cannes entre 6° et 9° a un distillat qui sort entre 75 et 80°. J’ai fait un distillat hier qui est sorti à 79°. On réduit les rhums à 45° ici, la réduction se fait au goutte à goutte donc il faut un certain temps. On utilise l’eau du mont dore qui coule ici pour la fabrication et la réduction du rhum (il s’agit de l’eau minérale la plus vendue de Nouvelle-Calédonie). Pour certains monovariétaux on a fait différents tests à différents degrés et on a choisi d’arrêter la réduction à 50° pour certains et à 55° pour d’autres. C’est une histoire de gout et de produit. Ça dépend de la canne bien sûr mais aussi de la terre sur laquelle la canne pousse. (Dans le sud de la nouvelle Calédonie il y a un parc naturel dont la terre est rouge, c’est dû à la haute teneur en fer de cette terre et on imagine bien qu’une canne qui pousserai dans cette terre pourrait développer des arômes spécifiques) On cherche à magnifier notre canne pas à uniformiser nos rhums.
P-R : Tu fais aussi des arrangés tu peux nous parler de cette gamme ?
PB : Bien sûr, la Calédonie est une terre riche et de nombreux fruits poussent ici naturellement. On cherche à mettre en valeur notre terroir. On a eu en tout une cinquantaine de recettes de rhums arrangés. On cherche, on expérimente. On a de la coco sur l’ile, des mangues, des litchis, de la papaye, de l’ananas, des agrumes. Mais on a aussi des fruits moins connus en métropole comme la pomme-cannelle, le corossol, la pomme-kanak, la pomme liane… On apporte un soin gustatif et visuel. On travaille avec des producteurs locaux. J’ai un producteur d’ananas basé dans le nord de l’ile qui envisage de planter de la canne pour utiliser la bagasse pour protéger ses champs, la démarche a du sens au niveau biologique. Il a juste un problème, il ne sait pas quoi faire du jus de cannes, je lui ai dit qu’on allait s’arranger (rires)
P-R : En dehors des rhums et des rhums arrangés ?
PB : On s’est amusés on a produit un whisky pur malt qui est actuellement en cours de vieillissement en fût, et un Gin qui plait beaucoup aux barmen locaux pour leurs cocktails. Là encore on a fait importer la baie de genièvre mais les plantes qui ont servi à sa fabrication sont toutes des plantes locales.
P-R : Ton marché c’est quoi ?
PB : 80% de nos produits vont aux supermarchés locaux et 20% aux débits de boissons et aux hôtels. Ça reste un peu compliqué de vendre de l’alcool à la population locale, les autorités surveillent bien plus qu’en métropole. Tu dois présenter ta carte d’identité pour pouvoir acheter une simple bière. Il faut dire qu’il y a eu pas mal de dérives. Avec les évènements récents il y a 25 000 personnes qui ont quitté la Calédonie, des gens qui ont eu peur pour leur vie ou pour la vie de leurs enfants. Parmi ces gens, il y avait aussi une clientèle un peu aisée qui pouvait mettre une certaine somme dans une bouteille pour avoir un produit plus qualitatif. Aujourd’hui, comme je disais, quand on voit certains produits qui inscrivent rhums sur la bouteille en rayon on se dit que les gens qui boivent ça doivent avoir bien mal à la tête le lendemain.
P-R : Je dois malheureusement aborder le sujet qui fâche avec tes récents cambriolages. Tu peux nous décrire un peu ce que tu as vécu pendant cette période et quel impact ça a eu sur ta vie et ton entreprise ?
PB : J’ai subi 9 cambriolages… Ma distillerie a été pillée 9 fois ! J’habite à une certaine distance de ma distillerie et la route qui y mène était impraticable avec un énorme barrage. Impossible de passer par la pendant les évènements. Lors des premières effractions, je devais me rendre au port, prendre un bateau et appeler des amis qui habitaient de l’autre côté de cette fameuse route pour qu’ils viennent me chercher. Souvent je ne pouvais que constater les dégâts. Ils prenaient toutes les bouteilles. Ils étaient à la recherche de tout ce qui peut se boire. J’avais un système d’alarme avec des caméras qui tournaient donc je pouvais les voir. On a essayé de renforcer la sécurité en condamnant les fenêtres et les portes avec des plaques d’acier. Ils ont défoncé les murs… Quand la route a été de nouveau sécurisée je pouvais être plus rapidement sur place et je contactais les gendarmes. Une fois arrivés sur place, même pris en flagrant délit, comme il n’y avait que des dégâts matériels, les cambrioleurs sortaient une heure plus tard à peine. J’ai décidé de tout déménager pour protéger ce qui me restait. Mais là encore il a fallu faire des pieds et des mains auprès des autorités locales pour pouvoir protéger mon activité. C’est dur de se dire qu’on cherche à faire un bon produit respectueux de l’environnement et des normes et que quand on demande de l’aide on a l’impression de devoir se débrouiller seul…
On a eu le COVID avec 3 confinements successifs, j’ai réussi à maintenir tous les emplois pendant la période même si c’était dur. L’alambic servait à fabriquer de l’ethanol parce que les pharmacies étaient vides… Je poussais l’alambic au maximum mais l’alcool titrait à 90/91° max… Après ça on se disait que ça allait repartir mais ces évènements nous ont flingué. Il y a un vrai coup d’arrêt. J’ai été obligé de licencier tout mon personnel. Aujourd’hui je fais tout seul, je distribue, je mets en bouteille, je distille, je broie la canne…
P-R : Je comprends mieux pourquoi tu n’as pas trouvé le temps de répondre à mon premier message. Est-ce que tu t’en sors financièrement avec tout ça ?
PB : J’ai dû emprunter pour acheter le matériel donc j’ai un crédit, ça fait 4/5 mois que je ne me verse plus de salaire. J’ai un jardin donc je plante de quoi vivre, les conditions sont dures pour moi mais c’est le cas pour de nombreuses personnes ici. L’économie a subit un énorme coup de massue avec les évènements récents.
P-R : Et bien merci Philippe il ne me reste plus qu’à te remercier chaleureusement d’avoir pris le temps de répondre à mes questions. On te souhaite une excellente continuation et on espère que la situation va rapidement s’améliorer pour l’ile. J’ai personnellement très envie de gouter des parcellaires calédoniens !!!
PB : Merci également pour votre temps et bonne continuation à Préférence-rhum.fr